Un premier essai raté car familier (ou l’inverse)…
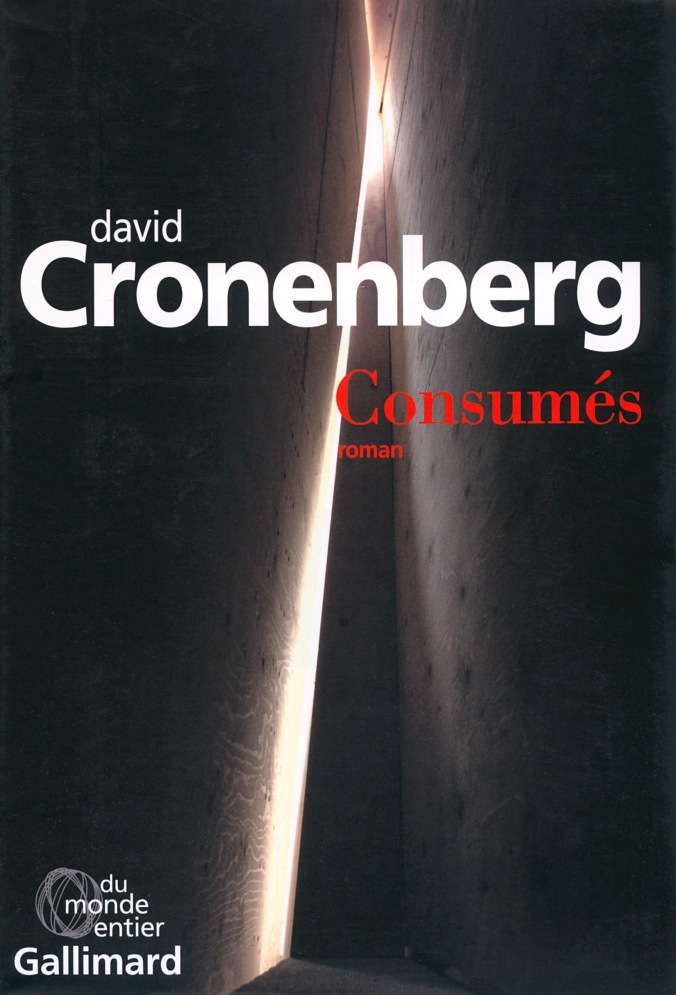
L’incipit à double détente pastiche l’ouverture de Vidéodrome, avant que la coda ne boucle la boucle du doute ontologique (et audiovisuel), à l’heure des simulacres-simulations de Baudrillard. Entre les deux, un digest (simplifié, sinon simpliste) de la filmographie, une transposition littéraire (à peine) de l’univers cinématographique, un miroir verbal (assez peu stendhalien) de la contemporaine réalité fictionnelle, l’ensemble, originellement paru en 2008 (pas d’insupportable impatience de la traduction-mutation française), propice au régal des amateurs de l’auteur – enfin, à soixante-dix ans dépassés, me voici romancier, ce que je voulais être/faire depuis le début – qui semblent confondre, dans leurs positifs comptes-rendus succincts, identité et qualité, reconnaissance et puissance, paresse et ivresse. Adoubé par Stephen King himself, qui s’effraie (s’enthousiasme) vite, pour pas grand-chose, Consumés se lit le sourire aux lèvres, « déjà ça », « toujours ça de pris », sa principale caractéristique humoristique apparemment passée inaperçue de lecteurs davantage captivés par sa supposée perversité, son évidente « noirceur », son statut de greffon par rapport à une œuvre sur grand (ou petit) écran elle-même rarement abordée sous un angle rigolard, alors qu’à l’exception notable de Chromosome 3, on peut rire à La Mouche comme autrefois à Psychose, Massacre à la tronçonneuse ou Salò ou les 120 Journées de Sodome (si, si, bien que l’on s’attende ensuite à trouver des clous dans sa polenta, grâce au gourmet Pier Paolo), métrages monstrueux, emblématiques (d’une époque, d’une manière de filmer) et en outre paradoxalement amusants.
De Paris (occupation d’une « chambre mansardée » du Crillon par la pauvre petite fille riche s’imaginant investigatrice) à Toronto (à demeure dans le « faux château » de l’ex-urologue voyeuriste, gentiment incestueux), de Budapest (ancienne capitale du X) à Pyongyang (poumon d’acier du « Royaume Ermite »), en passant par Tokyo (la maison d’Arosteguy évoque le cabinet-domicile des frères Mantle dans son laisser-aller terminal, l’humble professeur Matsuda, une caricature de la retenue bienséante nippone), le guide David nous balade (« nous mène en bateau », affirment les plus badins) dans un territoire psychique et physique, ludique et horrifique, érotique et technologique. Son Rouletabille à lui se nomme Nathan Math (patronyme guère recherché, surtout quand on connaît l’invention lexicale de Cronenberg, lecteur du séminal Nabokov) et « bosse » dans le photojournalisme (« à scandale »), en relation (parfois très intime, au moins le temps d’une éjaculation buccale imprévue) d’affaires et de cœur avec la juvénile (et ignorante) Naomi Seberg (une dénomination de star de cinéma, lui fait remarquer Hervé, le French Lover au nom (Blomqvist) « imprononçable », au pénis courbé en érection à quatre-vingt-dix degrés (maladie de La Peyronie), qu’il scanne en 3D à ses moments perdus), moins cultivée (« recadrée » par Madame Trinh, la « doctoresse vietnamienne », protectrice mémorielle, aux talons aiguilles colorés pourvus d’une lanière bondage), plus voyageuse (elle suit son sujet au Japon, histoire d’y vivre pour de vrai les « rêves de samouraï » de Max Renn ; notons que leurs prénoms entrelacés renvoient vers le Bevely de Faux-semblants ou le Brundlefly de La Mouche).
D’un docteur canadien et juif (Barry (Convex) Roiphe, ancien praticien hilare reconverti dans l’observation inquiète et intéressée, Anna & Sigmund en souvenir complice, de sa fille automutilatrice toujours à la maison, sorte de Tanguy maquettiste mâtinée d’Alice de Lewis, cf. le passage du goûter cannibale à personnalités multiples, auquel ne manque plus que la présence du Chapelier fou, mais vade retro Johnny Depp) à un médecin slave et international (le professeur Zoltán (Korda) Molnár, chirurgien taquin non homologué, adepte de l’argentique, des opérations-interventions, au sens artistique du vocable, par ailleurs « restaurateur » enclin au narcissisme), le couple va faire l’expérience de la nature incertaine de l’existence (des sentiments, des projets, des confessions), de l’unique assurance de notre mortalité (à moins que, suggère avec une finesse éléphantesque le constant déni/démenti du massacre inaugural et d’un effondrement final en pleine rue tokyoïte, dûment (et mal) filmé par des cellulaires, avant sa mise en ligne immédiate). Chacun de leur côté, in fine réunis par l’entrecroisement scolaire, attendu, des parallèles narratives, enquête selon son optique, personnelle ou professionnelle (les deux champs s’interpénètrent, évidemment), sur la résurgence possible d’une maladie vénérienne (transmise par Dunja, cancéreuse slovène en sursis, émouvant émissaire d’une esthétique de la laideur, de la pathologie, topos cronenberguesque, en partie hérité de Bacon, exposé depuis le fameux monologue de Frissons) et sur l’assassinat (supputé) de sa femme imputé au (pas si) terrible Aristide Arosteguy, philosophe libertin (écho amoindri à Diderot) épris de « plans à trois » (le triolisme spectral de Crash redessinait l’homoérotisme diffracté de Faux-semblants) gérontophiles avec étudiant(e)s, de « baston » cannoise et surtout de sa chère (sa chair) et tendre épouse Célestine (Amazone sexagénaire fumant des Gauloises, version Sorbonne de Nicki Brand), familièrement surnommée Tina (par admiration pour l’Acid Queen de Tommy, diantre !).
« Madame A. », vague avatar de Simone de Beauvoir, souffre de psychose apotemnophile (« une forme extrême de dysmorphophobie », reformule et explique Chase, pythie suspecte, progéniture francophobe (langue, pas pays) de Roiphe) et sent/entend (à l’unisson de l’héroïne du peu convaincant The Nest) des insectes pulluler, s’agiter, dans son sein gauche (emplacement diabolique, sinistre, si l’on s’en tient à l’étymologie), relie son mal à un ancien amour – il apparaîtra durant les dernières pages, via une connexion aléatoire, nous n’en saurons guère plus sur Romme Vertegaal, « éminence grise » (remember les rouges « cardinaux » munis de scalpels de Faux-semblants) signataire d’un disque bruitiste, « strident » et « stridulant » – parti découvrir en Corée du Nord le radieux paradis de la dictature cinéphile instaurée de père en fils (« Kimunisme », so). Qu’à cela ne tienne, le brave Molnár jouera bien volontiers les intermédiaires, guidera la main amoureuse du mari (lointainement inspiré de Louis Althusser, frère méconnu du Bill Lee du Festin nu) amputant, endurant, son témoignage (« sujet à caution ») déroulé en longueur avec le « je » (jeu) de rigueur. L’intrigue spéculaire, peu passionnante, peu passionnée, se déroule sur fond de cannibalisme spécieux (comprendre : à mise en scène et à effets spéciaux concoctés avec le concours de la société Arthropoda Souterrain), de consumérisme générationnel et de marxisme universitaire, de fétichisme Techno Geek (Cronenberg avoue se situer dans cette catégorie), de complotisme économico-idéologique à base de cyberkampf (« arène vidéo » 2.0) lié à l’audiologie (Elke Junglebuth, au physique dit ingrat, enfantée par deux « psys », on compatit) et d’existentialisme initiatique (on pense souvent au distrayant mais inutile eXistenZ, doublon mis à jour, en mode parodique, du fondateur et funèbre Vidéodrome).
Cela fait beaucoup (371 pages languissantes, douze chapitres tout sauf christiques ou européens) et peu à la fois, cela se voudrait une machine à fantasmes et une méditation à la Descartes, un voyage épistémique plus vertigineux que son invérifiable (et « chimérique ») vérité, un faux polar permettant de revisiter plus librement la thématique filmique, de la faire fusionner avec une représentation plus « débridée » (sans jeu de mots sur les yeux de la rivale amicale Yukie), par exemple dans le domaine de la sexualité. Hélas, trois fois hélas, Consumés, qui tire son titre du livre collaboratif hypothétique de Nathan & Barry, en réminiscence de The Shape of Rage au centre de Chromosome 3, mise en abyme cacochyme et jamais fertile, ne brûle d’aucun feu (a contrario, cf. Scanners), d’aucune empathie (à ne pas assimiler à de la rassurante sympathie, bien sûr, la lucidité du cinéaste lui interdisant les ficelles faciles du manichéisme, hollywoodien ou autre), d’aucune mélancolie (la tristesse désirante de Nathan pour Dunja, personnage prématurément abandonné, se réduit, à en croire ses dires à sa compagne « virtuelle », à une partie de baise « par pitié »), pourtant trois traits majeurs et charmeurs du corpus de Cronenberg. Il faudra donc (ou pas) se contenter du petit jeu des citations (on passe la main, celle de Dead Zone), de truismes philosophiques frisant la classe de terminale (valeur neurologique du réel, plasticité de la libido, solipsisme généralisé, labyrinthe de la subjectivité), d’un « jeu de l’oie » (le lecteur, ce « dindon de la farce » romanesque) conduit par un duo de fantoches un peu moches, un peu minables, un peu infantiles dans la bourgeoisie de leurs appétits, dans la désinvolture de leur luxure (Nathan ne mourra pas de sa circoncision-contamination, restera une silhouette désincarnée, jusqu’au bout, un comble toutefois logique, ici, à l’opposé de la Rose de Rage), dans l’indifférence de leurs mésaventures immobiles (fixer un écran de papier peut nuire à la santé du fan).
Comme débarrassé de la tunique royale talentueusement tissée par ses collaborateurs, le « roi » David se retrouve nu, aux prises avec la langue écrite, qu’il maîtrise, certes, en se tenant cependant à des années-lumière de Kafka ou Beckett (personne ne lui demande d’égaler ces deux maîtres, parmi d’autres en allusions ou correspondances (Zweig et son amoureuse, « brésiliens » suicidaires), mais on pouvait espérer/exiger mieux de sa plume habile à rédiger un scénario écrémé jusqu’à l’essentiel), concédant, en guise de mélodrame, quelques larmes (essuyons celles de M. Butterfly) à Naomi, « adultère » se répandant sur son clavier humide (pas celui, priapique, vaginal, du Festin nu) ou à Elke, la spécialiste sonore elle aussi éprise du Bernard-Henri Lévy de service, même si sa moitié, portée sur le lubrifiant génital « alimentaire », se pâme devant la parabole propagandiste sise au creux d’un village coréen « réactionnaire », s’extasie à l’intérieur des arcanes et des incarnations d’une entomologie métaphorique (manger ou être mangé, à l’ère du capitalisme mondialisé), plutôt que sur la plage et le marivaudage façon Rohmer, telle Arielle naguère. Que les béotiens et les zélotes se gargarisent avec leur appréciation révisionniste du pitoyable Passion de Brian De Palma (notre probable cinéaste de chevet, celui, en tout cas, et avec une poignée d’autres, à l’origine de notre cinéphilie), leurs louanges tardives de l’album sympathique et anecdotique d’un Carpenter « empêché » de filmer, suffisamment fatigué, âgé ou écœuré pour désormais cesser de tourner, avec le couronnement (à défaut de financement) rétrospectif, nécrophile, d’un alerte et showman (à la Cinémathèque, à Cannes) William Friedkin (ah, son stupéfiant Bug) – nous aimons trop le cinéma de David C. (ce foutu site en constitue la preuve monomaniaque) pour célébrer sa prose creuse, pour ne pas lui reprocher de n’avoir su se métamorphoser en quelqu’un d’autre que « le réalisateur de l’horreur viscérale et intérieure » traversant la frontière « poreuse » de la littérature (ah, l’Annexie libératrice et tragique de Bill Lee dans Le Festin nu). Cronenberg ne tua personne (présomption d’innocence, diagnostiquent les juristes), surtout pas sa femme, à laquelle il dédie aimablement son opus presque insipide, en réflexe conventionnel, en attention de tendre époux, signe sentimental à interpréter en confirmation de cet « équilibre délicat », flaubertien, reconnu par l’intéressé, entre le respect d’une norme sociale et le déploiement luxuriant d’une anarchie esthétique, dont parlait Peter Morris dans sa biographie lapidaire.
Sans surprise, sans perspective, délesté des puissances du cinéma, de leur totalité sensorielle, intellectuelle, sensuelle, individuelle, Consumés s’avère par conséquent une prothèse pas déplaisante, pas déshonorante, mais maladroite, mais manquée, parue, summum du « chic » trash, chez Gallimard (René G. le « papillon » peut commettre son seppuku tranquille). Nul doute que l’éditeur, hypnotisé par l’impression en relief d’un membre phallique démultiplié, à peindre puis à raccorder à la sculpture réaliste de la penseuse morte (paraît-il, allez savoir, ouvrez, si vous l’osez, ces deux fichiers « graphiques » disponibles sur clé USB), apprécia la dispensable dimension sociologique de la satire diluée dans le « placement de produit », ponctuée de termes et d’expressions francophones en italiques, Français (préfet de police) et Américains (touristes, remarquable réflexe pavlovien, canadien, face à l’ogre étasunien) se voyant affublés d’une abyssale stupidité, d’une vulgarité inguérissable, d’une superficialité satisfaite (notre réalisateur doit connaître le Frantic de Polanski). En ce qui nous concerne, rétif au sillage distancié d’écolière en marinière de Sailor Moon (?!), on oubliera, rapidement et sans regret, ces cendres froides et réchauffées, ce cadavre (pas exquis) en toc, juste et involontaire métonymie du récit (comparez-le avec un « cliché » de Weegee ou du martyre d’Elizabeth Short, dangereux et adultes puits de ténèbres d’une beauté hideuse), afin de nous replonger dans ses films, où bat brillamment le cœur contradictoire et cohérent, drôle et poignant, changeant et souverain de David Cronenberg, cinéaste iconoclaste et créateur fraternel.



